Une Plateforme Produit ne se conçoit pas comme un produit unique ou quelques spécimens. Pour une Plateforme Produit, la variabilité à prendre en compte change radicalement la donne.
Il ne s’agit pas seulement de faire un produit qui réponde aux besoins clients pour un coût et une qualité optimum, il faut concevoir une ligne de produits qui couvre les besoins clients pour une qualité et un coût global optimum.
La qualité et la fabricabilité doivent être garanties pour l’ensemble des cas qui seront proposés. Les investissements sont à analyser globalement. Il faut tout prévoir, mais pour autant prévoir, n’est pas faire ni tout ni tout de suite. Il est possible :
- de planifier des évolutions de la plateforme dans le temps,
- de détailler le design au fur et à mesure que les commandes le sollicitent,
- d’identifier pour certains modules des politiques de Just In Time Engineering ou de sur-mesure encadré.
Le coût doit être analysé globalement, peu importe que la marge soit faible ou forte pour certaines configurations pour autant que l’on atteigne la marge attendue, sur l’ensemble des ventes escomptées. Pour cette analyse, plusieurs facteurs sont à prendre en compte :
- la variabilité externe vue du client,
- le nombre de commandes attendues et leur répartition dans la combinatoire offerte,
- la variabilité interne des solutions mises en œuvre pour couvrir les futures combinatoires commandées.
Ces différences dans les objectifs de conception conduisent à revoir et à compléter les processus, les outils de conception et l’organisation, pour couvrir toutes les étapes de la conception d’une Plateforme Produit.
Acuity Solutions accompagne avec succès ses clients dans cette démarche depuis de nombreuses années en agissant simultanément sur ces 3 axes (processus, outils, organisation) tels qu’esquissés ci-après.
Les processus d’élaboration d’une Plateforme Produit
Nota : Ces étapes ne doivent pas être perçues comme séquentielles à exécuter une fois dans un ordre figé mais itératives car il va de soi qu’une plateforme doit être évolutive et que ce qui est vrai aujourd’hui peut changer demain. Il faut appliquer les principes d’amélioration continue qui pérennisent les investissements sur le long terme.
1/ Définir le périmètre fonctionnel ciblé

Le design de plateforme ne peut être optimum sans une bonne vision de la variabilité de la demande.
Cela demande une étude approfondie des requis clients au sens large, et leur déclinaison en requis technique sans présager des solutions techniques dans un premier temps. Ces études doivent aboutir à la vision de :
- la variabilité demandée (critères de choix proposés, interdépendance des choix sous forme d’implication ou de restriction)
- des volumes de vente attendus et probabilité des choix
- du cadencement des évolutions de la plateforme
Ces éléments sont déterminants pour élaborer les solutions de conception. Ils permettent par exemple d’estimer les volumes de pièces qui vont être utilisées par les futures commandes et par conséquent de faire des choix éclairés en matière d’outillage, de contrat d’achat ou de stratégie de design. Dans ce dernier cas, disposer de ces informations est un pré-requis à la décision de standardiser ou diversifier : bâtir une solution unique surdimensionnée dans certain cas ou plus ou moins segmenter les solutions en fonction des usages. (voir notre article Design 4 Variability)
Sur ce simple exemple on peut voir la différence entre concevoir une Plateforme Produit et concevoir un produit unique. Dans le cas d’un produit unique, le volume prévisionnel d’achat d’une pièce est simplement égal au volume de vente prévisionnel multiplié par la quantité unitaire de la pièce dans le produit fini.
Dans le cas d’une Plateforme Produit il est également fonction de la probabilité du cas d’emploi de la pièce. Cette probabilité est liée à la probabilité des choix qui vont être fait par le client mais doit aussi tenir compte des contraintes entre ces choix.
Ce référentiel de diversité doit d’être accessible à tous les intervenants au même titre que les autres requis des produits. Il doit clarifier ce qui est attendu, ou non, en matière d’options proposées actuellement et au fur et à mesure des extensions envisagées de l’offre. Ceci afin d’éviter de chercher des solutions pour des cas non demandés, ou de prendre des décisions négligeant le long terme.
2/ Bâtir l’architecture de la Plateforme Produit

L’Architecture Produit vise à bâtir l’agencement des entités élémentaires constituant le produit, et à définir les interfaces entre ces entités. Dans le cadre d’une plateforme, cette étape est d’autant plus essentielle qu’elle cloisonnera plus ou moins les impacts de la variabilité de la plateforme.
Une architecture mal construite engendrera une non-standardisation des solutions en regard de la diversité de la plateforme car chaque variation d’option impactera l’ensemble du produit. Au contraire une architecture pensée en diversité, limitera l’effet domino de la variabilité au sous-ensemble d’entités réellement concernées par l’option.

Les solutions techniques des modules génériques doivent, autant que possible, être substituables de manière transparente vis-à-vis des autres modules. Bien sûr, la réalité est bien plus complexe car on se heurte à des contraintes physiques et économiques où tout ne peut être interchangeable dans tous les cas. Des problèmes se posent notamment en termes d’agencement dans l’espace : volume disponible, passage de câbles, compatibilité électromagnétique, dispersion de chaleur, montage, réparation, démantèlement, … L’architecture de la plateforme doit prendre en compte la variabilité telle que définie à l’étape 1 pour construire l’architecture des modules, leur agencement, leurs interfaces. Cette architecture peut, elle-même, être variable en fonction de la variabilité du produit en identifiant des critères majeurs qui feront passer d’une architecture à une autre.
Cette définition de l’architecture doit aussi permettre de définir pour chaque module sa stratégie de conception : Solution unique, multiple, paramétrable ou sur mesure (voir notre article Design 4 Variability).
3/ Optimiser le design dans sa globalité
Une fois le périmètre de variabilité décrit et les grands axes de la conception définis, le design des solutions des modules peut être engagé. Il doit tenir compte de l’ensemble des métiers de l’entreprise dans une vision holistique du produit. Les informations concernant la probabilité de chacune des configurations doivent être prise en compte afin d’optimiser la plateforme dans sa globalité.

Acuity préconise pour cette étape d’adopter la démarche « Cocoon Optimization » (Concurrent ,Cooperative and On Going Optimization) (voir notre article à ce sujet), c’est à notre sens le moyen de prendre en compte l’ensemble des problématiques pour une réelle optimisation globale.
L’optimisation dans le cadre de la plateforme peut nécessiter des recherches complexes autour de la variabilité :
- Recherche de la consommation maximum demandée en fonction des options choisies
- Calcul du volume enveloppe d’un module quelle que soient les configurations
- Positionnement optimum des composants selon les combinatoires
La complexité de ces problèmes s’avère quelque fois exponentielle selon le nombre de critères de variabilité et les contraintes qui les relient. Pour ces recherches il est souvent nécessaire d’avoir recours à des outils spécifiques utilisant des techniques d’IA (recherche combinatoire, propagation de contraintes, algorithme génétique …).
4/ Valider le design de la plateforme

Comment valider le design de la plateforme dans sa globalité ? Comment s’assure-t-on que les règles de configuration sont bien complètes et cohérentes ?
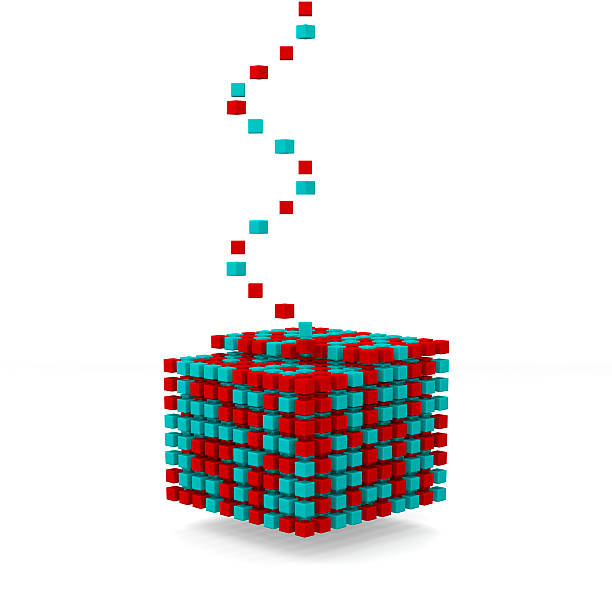
Validation exhaustive :
La première idée serait de valider une à une chacune des configurations possibles. Cette stratégie se heurte rapidement au mur de la combinatoire des choix proposés. En effet imaginons une plateforme ayant 20 critères de configuration ayant trois choix possibles chacun, la combinatoire est de 3^20 soit environ 3 milliards, en testant chacune ces combinaisons au rythme de 100 par seconde, il vous faudra environ 1 an pour toutes les valider : soyez patient ….

Validation modulaire :
Selon le principe cher à Descartes il suffirait de découper la validation en sous problèmes pour valider l’ensemble. On peut imaginer une validation module par module qui permettrait de valider l’ensemble de la plateforme.
Cette méthode aussi a ses limites, les problèmes d’interface et de comportement global y sont négligés. L’intégration des composants est cependant souvent le cœur du problème n’en déplaise à Descartes.
Validation par échantillonnage :
La validation se fait de manière traditionnelle sur quelques produits complets comme on le ferait dans le cas du développement d’un produit unique. Cela permet de valider les requis produits dans leur globalité. La limite de cette démarche vient du choix des échantillons testés. Comment les choisit-on ? Combien doit-on en tester ? Sont-ils significatifs ?

Le choix de ces échantillons doit tenir compte de plusieurs facteurs : la pertinence technique (tester les cas les plus contraints), la probabilité de la configuration (tester les cas les plus fréquents), les irrégularités (tester les cas suspects), tester les nouveautés.
L’identification de ces cas peut être :
- confiée à des experts des métiers qui, par leur expérience, sauront repérer ces cas,
- soumise au hasard pour une partie
- proposée par algorithmes se basant sur des heuristiques spécifiques
Validation mixte :
En pratique dans le cas d’une plateforme, la validation consiste à minimiser les risques et toutes ces méthodes (semi-exhaustivité, module, échantillonnage) doivent être combinées pour ramener le risque à un niveau acceptable en optimisant les tests.
5/ Conception opportuniste, étape par étape

Les étapes de Design et de validation de l’entièreté de la plateforme peuvent représenter un coût et un délai incompatible avec le volume des ventes et les délais de mise sur le marché attendus.
À quoi bon étudier toutes les combinatoires alors que l’on n’en vend que quelques-unes par an ? Même si la conception de la plateforme est modulaire pourquoi étudier dans le détail chacune des configurations des modules ?
Lorsque les délais de livraison le permettent il peut être intéressant de faire la conception détaillée de certaines configurations uniquement lorsqu’un client en a besoin. Cette démarche permet de limiter les investissements initiaux, néanmoins elle doit être appliquée dans un cadre strict respectant les règles suivantes :
- l’étude d’architecture doit garantir la faisabilité de la conception dans un délai global compatible avec le délai de livraison (temps d’étude + approvisionnement + fabrication inférieur au délai de livraison client)
- l’étude détaillée déclenchée par la commande client doit se faire dans le contexte de la plateforme et pas seulement dans le contexte client. Les exigences à prendre en compte sont celle de la plateforme et pas seulement celle de la configuration demandée par le client
- l’étude finalisée doit être intégrée dans la plateforme comme un livrable générique non typé client afin de pouvoir être réutilisée par une commande ultérieure.
6/ Prévoir l’évolution de la plateforme
La plateforme ne doit pas être vue comme un objet figé mais qui va évoluer au cours du temps pour intégrer de nouvelles options, lever des contraintes, améliorer ses solutions, modifier son architecture, intégrer les retours d’expérience et réalisation client.
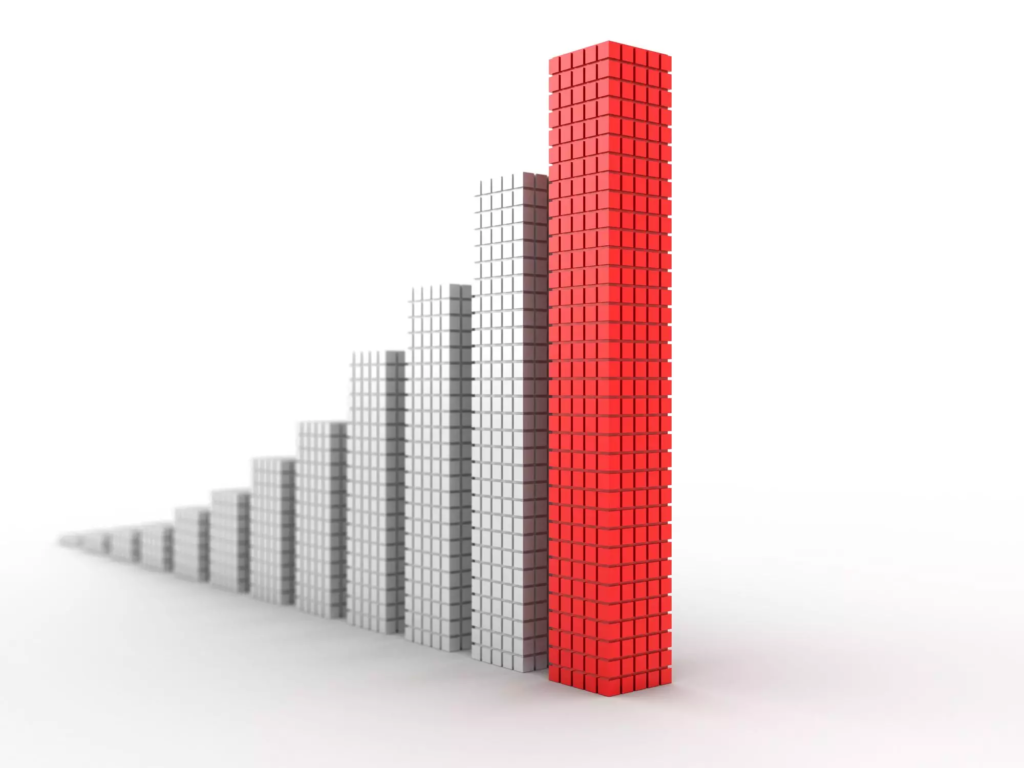
L’ensemble de ces modifications petites et grandes doivent être planifiées dans le temps et menées en parallèle. Cette planification et leurs impacts doit être visibles et compréhensibles par les équipes en charge de la conception. Ce sont des informations fondamentales pour gérer les priorités, concevoir de manière pérenne et évolutive, identifier les impacts et bénéficier dans les développements futurs des modifications planifiées aux étapes précédentes.
Les outils
Comme on a pu le voir précédemment, le point central de la conception d’une plateforme est la maîtrise de la variabilité :
- Variabilité demandée par le marché
- Variabilité générée par l’architecture et réalisées via les solutions de conception
Les outils de PLM gèrent parfaitement les livrables de conception (cycle de vie, maturité, dépendances, classification, confidentialité, …) mais sont très limités dans leur capacité à gérer les règles de configuration et les problématiques associées tels que présentés précédemment.
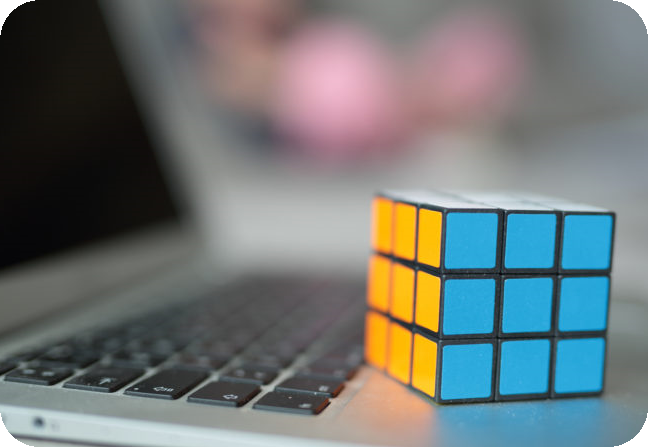
Les précurseurs en ce domaine ont longtemps été les constructeurs automobiles qui ont développé en interne leur propres outils à partir des années 70. L’avènement des solutions PDM puis PLM à partir des années 90 a conduit le plus souvent à des solutions mixtes associant un outil « maison » pour la partie configuration de la variabilité, à un outil PLM du marché pour la gestion des livrables.
Les outils « maison » couvrent bien les besoins historiques de gestion de la variabilité mais sont souvent technologiquement dépassés et peinent à couvrir les nouveaux besoins (éco conception, électronique, logiciel, intégration des fournisseurs dans la conception en variabilité, co-développement, …).
Ce sont ces limites qui ont conduit Acuity à créer PLEiADE comme outil de gestion d’une ligne de produit capable de s’interfacer avec les outils PLM de gestion des livrables. L’idée étant de ne pas simplement « gérer » ces données mais de les mettre à disposition de tous, les rendre intelligibles, les utiliser pour leur donner du sens, faire des prédictions, suivre l’avancement, analyser leur qualité.
Le défi étant de rendre accessible des informations complexes en leur gardant leur sens pour qu’elles puissent être consultées et mise à jour par les métiers sans intermédiaire.
L’organisation
Le pilotage de la Plateforme Produit demande une organisation et un budget spécifique pour la construire et la faire vivre. Il est important de séparer les activités liées à la Plateforme Produit de celles liées à un projet/commande client. C’est en effet un moyen de garder un équilibre entre :
- les objectifs globaux liés à la plateforme qui doivent s’inscrire dans la durée avec des notions d’investissement long terme
- les objectifs court terme de qualité et de délai liés à une commande client
Sans cette organisation à deux têtes, le risque existe que tout le focus soit mis sur la réalisation des commandes client les unes après les autres sans construction d’une plateforme permettant, à terme, de mutualiser la conception et d’anticiper les changements.

Côté équipe projet/commande client, les études réalisées à l’occasion d’une commande client, dans une démarche de conception opportuniste telle que décrire précédemment, doivent être réalisées au titre de la plateforme dans le contexte « pluriel » lié à la diversité ciblée par la plateforme et pas uniquement dans le contexte de la commande en cours. Le cas d’emploi de la solution à concevoir doit embrasser l’ensemble des cas prévus. L’équipe plateforme a la responsabilité de valider la conception dans ce cadre plus large.
En revanche, les études spécifiques à une commande client et n’ayant pas vocation à intégrer la plateforme restent dans le périmètre des équipes projet/commande. L’équipe plateforme veillera uniquement à analyser les causes de ces écarts pour éventuellement décider de faire évoluer la plateforme en conséquence.
Conclusion
Comme exposé précédemment, la conception d’une Plateforme de Produit demande de faire évoluer méthode, outils et organisation. Cela peut paraître complexe à mettre en œuvre mais deux points sont à prendre en compte : l’importance des enjeux et la maturité des solutions facilitant cette mise en œuvre.
Les enjeux
- L’amélioration de l’offre Produit
Une Plateforme Produit permet d’élargir l’offre, de faire du sur mesure « Premium » pour un coût proche du standard, d’améliorer la valeur ajoutée client, d’avoir une image Produit globale.
- Excellence opérationnelle
Cela permet aussi de raccourcir les délais de mise sur le marché des nouveautés sur l’ensemble de l’offre, de décorréler l’effort de conception du nombre d’affaires à traiter, d’améliorer la rentabilité et la compétitivité par les effets de la standardisation des modules.
- Globalisation du service
Une offre moins disparate permet d’optimiser la qualité, le soutien, la réparabilité et de diminuer les coûts de garantie.
Peu d’initiatives permettent d’intervenir sur l’ensemble de ces points en même temps. Les enjeux sont donc très importants.
Les solutions
Les solutions à mettre en œuvre existent, il faut cependant reconnaitre qu’elles ne sont pas encore très diffusées chez les intervenants généralistes, mais chez Acuity Solutions nous les pratiquons avec succès depuis de nombreuses années. Le fait d’agir simultanément sur les 3 axes, méthodologiques, organisationnels et outils, est essentiel.
Comme le disais Jigoro Kano le fondateur du judo, « Plus l’ascension est longue, plus la montée est difficile, plus grande sera la satisfaction et plus magnifique sera la vue une fois au sommet. »
Je rajouterais que l’Acuiteam se fera un plaisir de vous guider et assister sur ce chemin.


